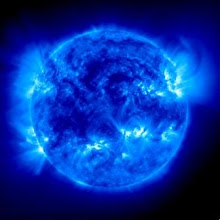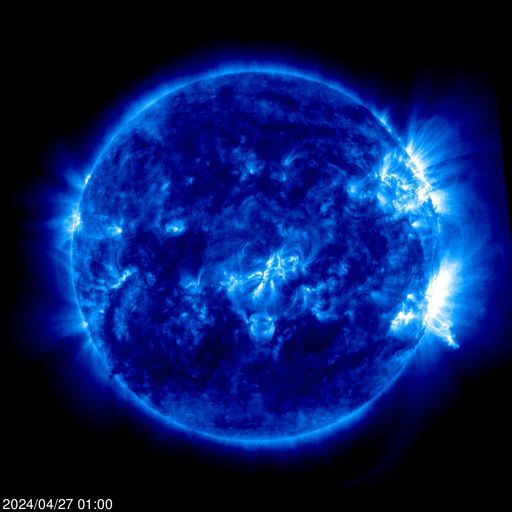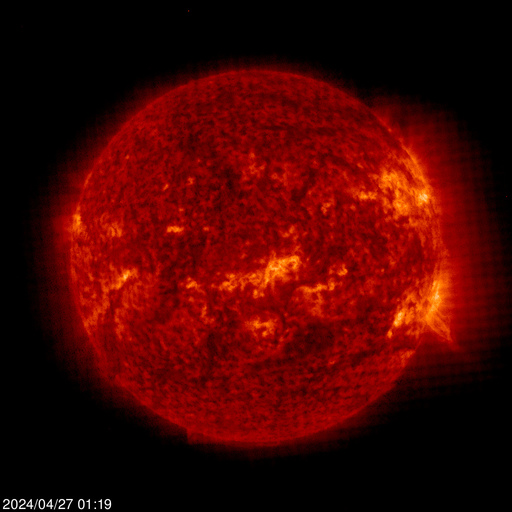Andromède en ultra violet
Voici l’image la plus fine jamais réalisée en ultra violet de la galaxie d’Andromède, M31. Habituellement occupé à chercher les gigantesques explosions cosmiques, le télescope spatial Swift s’est cette fois concentré sur la galaxie la plus proche de notre Voie Lactée.
 Version HD (8 Mo)
Version HD (8 Mo)Environs 20.000 sources UV apparaissent sur ce cliché. Elles mettent en évidence le rayonnement de jeunes étoiles et d’amas stellaires denses. Le cœur galactique est moins brillant que les bras, ce qui s’explique par le fait qu’il est essentiellement composé d’étoiles mures, rayonnants moins dans l’UV.
Ce cliché est une mosaïque de 330 images couvrant un champ d’environs 200.000 années lumière.
Ce cliché est une mosaïque de 330 images couvrant un champ d’environs 200.000 années lumière.
Source Ciel & Espace

Andromède en visible